- Votre musique
- Nos sélections
- Les incontournables
- Sorties de la semaine
- Sorties à venir
- Coup de coeur
- Focus label : Numero Group
- Repress Rap français
- Black Friday
- Genres Musicaux
 Rock
Rock Rap
Rap Chanson Française
Chanson Française Electro
Electro Jazz, Blues
Jazz, Blues Reggae
Reggae Soul, Funk & Disco
Soul, Funk & Disco Musiques Du Monde
Musiques Du Monde Classique
Classique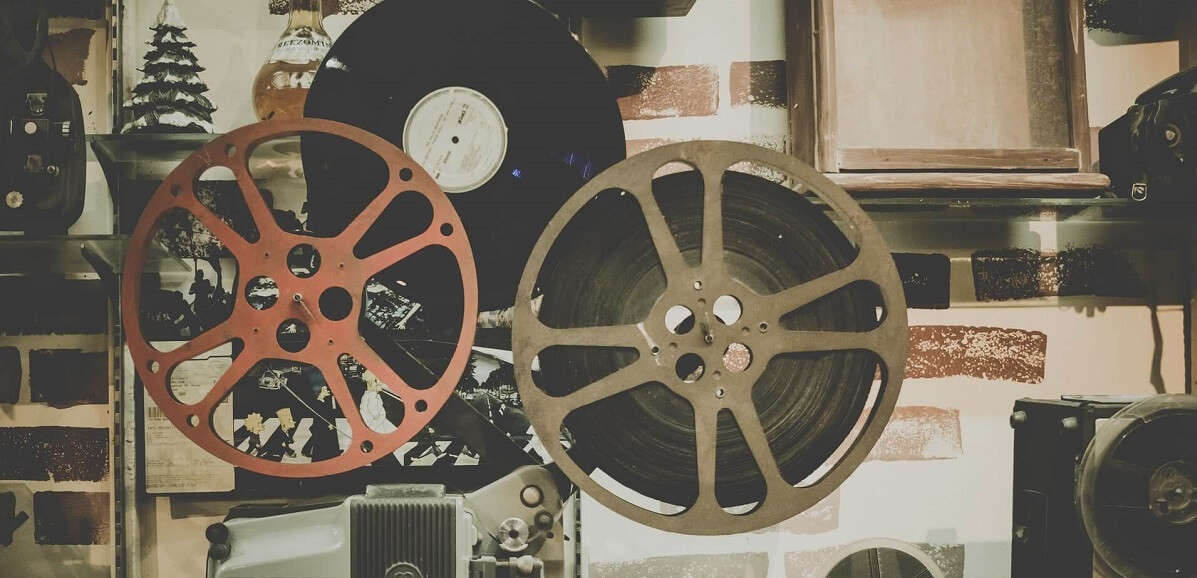 B.O Films, Jeux Vidéos & Library
B.O Films, Jeux Vidéos & Library
- Bons cadeaux
- Petits prix
- Pochettes de protection
Livraison offerte en point relais dès 60 € d'achat !
Livraison offerte en point relais dès 60 € d'achat !
Allez au contenu
Besoin d'informations ?
[email protected]- Créer un compte
Mon panier
Mon panier Livraison Paiement
Rechercher
Le jazz
Le jazz est né dans les états du sud des Etats-Unis, notamment en Louisiane, lorsque les marching bands et autres brass bands se développent et commencent à rythmer les différents événements de la vie au tout début de XXème siècle. Ces fanfares tiennent leurs racines à la fois de traditions importées par les esclaves noirs (les work songs), du blues qui naît à peu près au même moment dans le Delta du Mississippi, des styles de piano ragtime et stride, mais aussi des marches militaires en provenance d’Europe. Les étymologistes ne sont pas tous d’accord mais il est probable que le mot « jazz » vienne du français « jaser ». N’oublions pas que La Nouvelle Orléans a été française pendant longtemps et le créole qui s’y est développé est imprégné de notre langue...


Petit à petit les orchestres jazz (ou dixieland, comme on avait l’habitude de les nommer au début) commencent à jouer dans des clubs ou sur les fameux bateaux à roues (« sternwheeler » en anglais) qui sont des lieux de perdition au sein desquels prospèrent jeux, proxénétisme et alcool. Dès le début le jazz est donc une musique canaille, une musique pratiquée par des afro-américains venant de milieux pauvres et qui ont pour beaucoup des parcours de vie chaotiques (drogues, alcool, prison sont des grands classiques). A la suite de Kid Ory, l’Original Dixieland Jass Band ou Jelly Roll Morton, émergent deux artistes majeurs : le clarinettiste Sidney Bechet qui aura une notoriété particulière en France puisqu’il s’installera à Antibes et le trompettiste / chanteur Louis Armstrong, l’une des plus grandes stars que le jazz ait donné au monde de la musique.


Louis Armstrong


Sidney Bechet
L’entre-deux guerres mais plus particulièrement les années 1930 vont voir le jazz se métamorphoser : les clubs sont de plus en plus nombreux, le genre s’est propagé via les radios et les premiers phonogrammes dans les villes du nord, les blancs commencent à s’y mettre et les orchestres deviennent plus amples. Cette période « swing » est considérée par beaucoup comme le véritable âge d’or du genre qui, paradoxalement, est condamné à se réinventer : basé sur l’improvisation et la liberté de jeu, le jazz est éternellement en mutation sous l’impulsion de ses propres acteurs. D’ailleurs, il vaudrait presque mieux parler « des » jazz tant les esthétiques peuvent varier d’une chapelle à une autre.
Cette période sera aussi celle des big bands, notamment ceux de Duke Ellington et Count Basie. Titres de noblesse auto-proclamés, allures de pimps tirés à quatre épingles, cigares aux lèvres, menant un orchestre imposant aux cuivres puissants, ils incarnent à eux deux le swing, son exubérance et sa bonne humeur. Bonne humeur qui n’est parfois que de façade puisque les conditions des vies des afro-américains, même celles des musiciens connus, ne s’améliorent guère dans un pays encore très largement dominé par la ségrégation raciale. Si Ellington et Basie sont clairement les têtes de proue du swing, il serait injuste de ne pas citer le clarinettiste Benny Goodman et le tromboniste Glenn Miller (qui disparaîtra au combat durant la Seconde Guerre Mondiale). En effet, ils sont les premiers blancs à rencontrer un réel succès, ce qui fait d’eux, en plus de leurs talents musicaux, des vraies figures légendaires du jazz.


Duke Ellington et son Big Band


Count Basie et son Big Band
Au début de la décennie 1940, des jeunes jazzmen arrivent, ayant souvent fait leurs classes dans les grandes formations big band, et veulent donner une autre tonalité : l’heure n’est plus à la fête, une Seconde Guerre Mondiale a éclaté en Europe. Les afro-américains, s’ils n’ont toujours pas les mêmes droits que les blancs, ont quand même le devoir d’aller défendre les intérêts de l’Amérique... Du swing, nous passons donc au be-bop (ou plus communément bop). Le tempo s’accélère, les orchestres sont remplacés par des formations plus restreintes (du trio au sextet en général) et la mélodie se fraye un chemin différemment dans les solos techniques des instrumentistes, saxophonistes en tête. Bien sûr l’ancienne école criera au scandale, arguant que cette musique n’est plus du jazz mais cela n’empêchera pas Charlie Parker (dit « Bird »), John Coltrane ou Thelonious Monk de se faire une place de choix à la fois dans les clubs et sur les 33 Tours tout juste arrivés sur le marché.






Les années 1950 verront encore le jazz muter mais en partant dans des directions opposées. D’un côté nous avons Miles Davis théorisant que les notes que l’on n’entend pas sont plus importantes que celles qu’on entend. De l’autre, une poignée de jazzmen poussent encore plus loin le bop dans des territoires extrêmes.
Le cool jazz (ou « West coast ») aura une influence majeure. Tout d’abord il est porté par Miles Davis, trompettiste de génie à la personnalité solaire qui fascine le public. Avec ses albums Birth of the cool (1957) puis Kind of blue (1959), il va révolutionner le genre en proposant un son deep, lent, enveloppant qui invite à la rêverie et l’introspection. Ensuite, les blancs (le public comme les musiciens) s’emparent en masse de ce nouveau son jazz qui est bien plus simple à suivre (et donc à acheter) que la syncope du bop ou le tintamarre des cuivres du swing... En effet, le cool est beaucoup plus inoffensif car il ne porte pas en lui de revendications ; il est clairement destiné à des ambiances cosy qui collent parfaitement à « l’american way of life » du moment.




Le pendant du cool est le hard bop dans les fifties. Pensant que le bop doit être poussé plus loin, ramené vers ses racines blues brutes, une bande de musiciens développe ce son mené par une rythmique mise au premier plan : Art Blakey et ses Jazz Messenger, Sonny Rollins, Charles Mingus, les frères Adderley, Herbie Hancock, McCoy Tyner etc. Ces musiciens feront à cette époque les grandes heures du label Blue Note Records, maison fondée en 1939 mais qui est pour beaucoup d’amateurs, l’incarnation même du hard bop de la fin des 50’s. Blue Note perdra de sa superbe à la fin des années 1970 mais sera reprise en 1984 et verra de nouveau le succès lui sourire en s’adaptant à son époque, signant US3, St Germain ou Norah Jones notamment.












Un autre label incontournable de la même époque : Impulse! fondé en 1960 par le producteur Creed Taylor sera le label historique de John Coltrane et sera responsable de belles sorties bop, hard bop mais aussi du free naissant avec Ornette Coleman, Archie Shepp ou Albert Ayler. Les tranches orange et noires font la joie des collectionneurs de vinyles car elles sont immédiatement reconnaissables dans une étagère. On compte aussi parmi leurs sorties des albums mythiques de Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Gabor Szabo, Ahmad Jamal, Sun Ra ou Freddie Hubbard.






Les années 1970 sont synonymes de funk et de disco, deux genres nés au travers de la communauté afro-américaine, il n’est donc pas étonnant que le jazz ait encore muté au contact de ces sons. Avec Herbie Hancock et ses Headhunters, Miles Davis, George Duke, les brésiliens d’Azymuth et Deodato, Donald Byrd ou Idris Muhammad, le jazz délaisse son côté sérieux et raide pour s’acoquiner avec le dancefloor : les batteurs jouent des break beats que les producteurs de hip hop sampleront 20 ans plus tard, les basses sont désormais électriques, les cuivres sont un petit peu délaissés au profit de la guitare et surtout des synthétiseurs qui ont fait leur apparition. Du jazz funk on est vite passé au jazz rock quand une poignée d’artistes (souvent blancs), se sont emparé de ce nouveau jazz mais en y injectant leur background plutôt rock teinté de psychédélisme : Frank Zappa, Weather Report, Return To Forever, Stanley Clarke, Billy Cobham ou le Mahavisnu Orchestra pour n’en citer que quelques-uns.












Depuis la fin des années 1970, le jazz a continué à creuser ses sillons historiques (swing, bop, cool, free, jazz funk etc.) à travers le monde, et particulièrement en France qui a toujours bien accueilli cette musique, mais s’est aussi laissé inviter à croiser le fer avec tout un tas de folklores différents ; que ce soit celui des Antilles, d’Europe de l’est, d’Inde, du Japon, d’Afrique noire et d’Amérique du Sud. L’engouement pour le jazz ne faiblit pas si l’on se fie au nombre de rééditions de vinyles devenus rares issus de la production pléthorique entre 1965 et 1985 (en gros). Un tas de labels font un travail formidable pour archiver et remettre en lumière des chefs d’œuvre rares ou perdus : Jazzman Records en Grande-Bretagne avec notamment sa série de compilations Spiritual jazz, Digger Digest pour le jazz antillais (Belenou, Edmony Krater, José Manclière, V.S. Quartet) ou des raretés jazz hexagonale (Rupture, Cossi Anatz), Universal Sounds, le sous-label de Souljazz dédié au jazz indépendant US, BBE Records, We Release Jazz ou Wewantsounds pour le jazz japonais, Mr Bongo pour le côté brésilien, les allemands de MPS qui ressortent une partie de leur excellent catalogue etc.






Tout ça sans compter que de « jeunes » musiciens à travers le monde, notamment britanniques (car Londres recèle d’une scène jazz très riche qui n’hésite pas à puiser dans le hip hop ou l’électro), construisent leur jazz en s’appuyant plus ou moins sur la tradition. Et c’est bien cela le jazz : adapter cette musique à son humeur, son background ou ses goûts esthétiques !
Le Blues
La fin de la Seconde Guerre Mondiale est accompagnée d’énormes bouleversements : l’électricité arrive un peu partout et les usines du nord aspirent la main d’œuvre du sud en quête d’une vie meilleure. Le blues suit le mouvement et déplace son centre névralgique du Delta du Mississippi vers Detroit et Chicago où des clubs ouverts à cette musique accueillent les héros du moment : Muddy Waters, Howlin’ Wolf (surnommé ainsi à cause de sa façon de chanteur rappelant le cri du loup), John Lee Hooker, Elmore James, B.B. King, Willie Dixon, Buddy Guy, Otis Rush, Luther Allison, T-Bone Walker, Lightnin’ Hopkins ou Sonny Boy Williamson.






Tous ces bluesmen auront une influence considérable sur le rock et seront même considérés comme des modèles absolus par des formations telles que les Rolling Stones, Cream, John Mayall & The Bluesbreakers, ou The Yarbirds. Groupes qui constitueront d’ailleurs le cœur de ce qu’on nommera la « British blues invasion » dans les années 1960.






Depuis cette époque la porosité entre le rock et le blues n’a cessé d’opérer : les bluesmen lorgnant bien souvent vers le rock et les rockers empruntant régulièrement au blues (Jimi Hendrix, Janis Joplin, ZZ Top et tant d’autres). De très grands artistes blues sont également apparus depuis les 70’s tels que Keb’ Mo, Lucky Peterson, Stevie Ray Vaughan, Taj Mahal, Poppa Chubby ou Joe Bonamassa pour n’en citer que quelques-uns.
Si le paysage du blues est largement dominé par les hommes comme dans beaucoup d’autres styles musicaux, il est intéressant de noter que des femmes ont tout de même joué un rôle primordial dans son histoire (Big Mama Thornton, Ruth Brown, Mahalia Jackson, Billie Holiday, Big Maybelle, Rosetta Tharpe etc.) et que la relève est assurée par des personnalités fortes telles que Beth Hart ou Samantha Fish.
Bibliographie
- Marc Alvarado « Jazz rock » (Le Mot et le Reste)
- Maxime Delcourt « Free jazz (Le Mot et le Reste)
- Nicolas Fily « John Coltrane : the wise one » (Le Mot et le Reste)
- Ashley Khan « Kind of blue » (Le Mot et le Reste)
- Thierry Pérémarti « Visiting jazz » (Le Mot et le Reste)
- Matthieu Thibault « Bitches brew ou le jazz psychédélique » (Le Mot et le Reste)




